Par Bertrand Louart
Extrait de Réappropriation (2022)
★ ★ ★
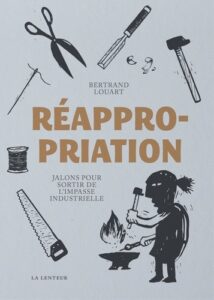
LA TENTATION LÉNINISTE
De nos jours, chez certains intellectuels critiques à l’égard du monde tel qu’il ne va pas, et peut-être justement parce qu’il n’y a plus de classe aux aspirations révolutionnaires, la référence à Lénine revient à la mode. Mais comme disait Marx :
“Hegel remarque quelque part que tous les grands faits et les grands personnages de l’histoire universelle adviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce[1].”
Le Manifeste accélérationniste, publié en 2013 par les universitaires Alex Williams et Nick Srnicek[2] avance l’idée que pour renverser le capitalisme, « système injuste et pervers, mais aussi […] obstacle au progrès », il faut chercher à le dépasser plutôt que de lui résister. Selon eux, les forces de gauche doivent « tirer parti de toute avancée scientifique et technologique rendue possible par la société capitaliste », car « seule une politique prométhéenne de maîtrise maximale sur la société et son environnement peut permettre de faire face aux problèmes globaux ou atteindre une victoire sur le capital ». Ironisant sur les mouvements sociaux « qui s accrochent à un folklore politique nourri de localisme, d’action directe et d’horizontalisme intransigeant » et leur manque d’efficacité stratégique, ils appellent à « abandonner le privilège exagéré actuellement accordé à la démocratie-comme-processus » et dénoncent « la fétichisation de l’ouverture, de l’horizontalité et de l’inclusion, qui caractérise une large part de la gauche radicale d’aujourd’hui ». Il faut préciser que ce manifeste contient une seule citation : celle de Lénine que nous avons donnée plus haut[*].
La farce accélérationniste montre que l’industrialisme continue d’imprégner les imaginaires de ceux qui se revendiquent critiques, subversifs, voire révolutionnaires. En effet, nos accélérationnistes ne sont pas seuls. On retrouve le même prétendu « réalisme politique » et l’idée qu’il serait possible de sortir du capitalisme « par le haut », sans rien perdre des commodités matérielles qu’il nous dispense, chez d’autres auteurs.
Prenons l’historien suédois Andréas Malm, qui a brillamment démontré dans son ouvrage L’Anthropocène contre l’histoire (que nous avons cité plus haut[*]) que la notion d’« anthropocène » dépolitise la question du changement climatique en faisant de « l’humanité » tout entière la responsable des émissions de gaz à effet de serre. Revenant sur les origines historiques de l’usage des combustibles fossiles, il montre que ce sont d’abord les nations engagées dans le développement industriel qui les ont pillés à travers le monde et gaspillés pour le développement de leur propre puissance. Les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre sont en fait les nations industrialisées et, à l’intérieur de ces nations, ce sont les classes propriétaires et dominantes qui consomment le plus d’énergie. Malm en vient à la conclusion qu’il serait plus juste de qualifier la période où nous vivons de « capitalocène ».
L’argumentation de Malm sur ce point est convaincante et solidement étayée par des exemples historiques. Mais lorsqu’il examine les possibilités de contestation sociale liées au changement climatique, il fait l’éloge du « projet bolchevique » et plaide pour un « léninisme écologique ». Il conclut de manière surprenante son raisonnement en regrettant – comme les accélérationnistes – que dans les milieux activistes « l’action horizontale directe reste fétichisée » et nous assène cette « leçon » de Lénine :
“La question du pouvoir est certainement la question la plus importante de toute révolution[3].”
Cet historien n’ignore rien de la manière dont s’est terminée la prise du pouvoir par les bolcheviks, le système totalitaire, l’industrialisation à marche forcée, etc. Il ne s’en revendique pas moins au moment d’énoncer un programme consistant à « arracher l’État » des mains des politiques et à « diriger l’investissement public vers le développement et la diffusion des technologies d’énergie renouvelable et durable les plus efficaces [4] ». Le livre se conclut donc par un mélange de solutions étatiques et de naïveté complaisante vis-à-vis des nouvelles technologies.
On retrouve cette posture chez un Frédéric Lordon, qui tourne en ridicule les tentatives de remettre en cause le modèle industriel.
“On ne fait pas une formation sociale avec juste un recouvrement de ZAD, ou de « communes » ; le lyrisme des cabanes, des forêts et des ZAD fouette sans doute nos imaginations, mais ne soutient pas une perspective politique pour le nombre[5].”
Lordon réhabilite Lénine, Trotski, dictature du prolétariat et Grand Soir « sans rien oublier des abominations qui sont venues avec[6] », mais sans nous dire comment il compte s’y prendre pour éviter de les reproduire. Si on traduit en bon français les idées de Lordon sur la manière de renverser le capitalisme, il faudrait une volonté politique émanant du sommet de l’Etat afin de légitimer et d’encadrer le « changement social » qui affectera les masses. La révolution doit venir d’en haut, être planifiée, organisée et dirigée d’une main de maître, car la révolte d’en bas est toujours brouillonne, sans lendemains ni perspectives[7].
Malm souhaite que l’État soit arraché des mains des puissants afin de mettre en œuvre un programme de transition qui réorganise l’industrie et l’économie pour quelle émette moins de CO2 – sans mentionner l’industrie nucléaire. Lordon est attentif à conserver la division du travail à la source du confort matériel dont selon lui la population ne saurait se passer, et veut transformer le droit de propriété dans le cadre d’un bon vieux capitalisme d’Etat[8], car :
“Le capital est une puissance macroscopique et on n’en viendra à bout qu’en lui opposant une force de même magnitude[9].”
Derrière ces appels à une puissance publique éclairée par la raison et la science, la dépossession de chacun sur sa propre existence du fait de sa dépendance à la production marchande et industrielle non seulement reste intacte, mais est reconduite comme seule perspective politique capable de susciter l’adhésion des masses. Il ne faut pas s’étonner que le marxisme soviétique, en tant qu’idéologie scientifique, planificatrice, bureaucratique et industrielle, ne soit pas critiqué.
Nos léninistes ont en fait une conception totalement idéaliste de la politique : pour eux, le pouvoir est un instrument neutre entre les mains de dirigeants qui peuvent être bons ou mauvais. Ils veulent encore et toujours croire qu’un ou des hommes providentiels, intègres et déterminés, prenant la direction d’un appareil d’Etat ou d’une organisation révolutionnaire hiérarchisée, viendront en sauveurs – en dépit de tous les démentis que l’histoire a pu apporter[10]. En fait, la contre-révolution se situe précisément dans la prise du pouvoir.
Dans sa critique de l’économie politique, Marx a mis l’accent sur les moyens de production comme moteur de l’histoire et ce depuis les débuts de l’humanité, projetant ainsi sur le passé la dynamique propre au capitalisme industriel de son temps. Pour paraphraser le Manifeste du parti communiste, il serait plus juste de dire que l’histoire jusqu’à nos jours est l’histoire de l’accumulation du pouvoir et du déploiement de la domination en des formes de plus en plus aliénantes[11].
En 1934, la philosophe française Simone Weil (1909-1943) avait fait de ce thème le centre de ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale :
“La puissance enferme une espèce de fatalité qui pèse aussi impitoyablement sur ceux qui commandent que sur ceux qui obéissent ; bien plus, c’est dans la mesure où elle asservit les premiers que, par leur intermédiaire, elle écrase les seconds. […] Conserver la puissance est, pour les puissants, une nécessité vitale, puisque c’est leur puissance qui les nourrit ; or ils ont à la conserver à la fois contre leurs rivaux et contre leurs inférieurs, lesquels ne peuvent pas ne pas chercher à se débarrasser de maîtres dangereux ; car, par un cercle sans issue, le maître est redoutable à l’esclave du fait même qu’il le redoute, et réciproquement ; et il en est de même entre puissances rivales[12].”
Tant que la domination reposait, comme c’était le cas depuis l’Antiquité jusqu’aux Lumières, sur des relations sociales interpersonnelles et un ordre social garanti par un certain nombre d’institutions politiques, elle restait en quelque sorte à « visage humain », elle n’avait pas les moyens de ravager le monde et détruire toute forme de société, même si les guerres, l’impérialisme, l’esclavage, etc., ont pu engendrer des exactions, atrocités et destructions considérables. Les dominants exerçaient leur pouvoir bien sûr d’abord dans leur propre intérêt, mais également avec un souci du bien commun national et populaire, leur puissance en étant étroitement dépendante. Car toute forme de domination suppose une adhésion – toujours partielle et fragile – des dominés aux valeurs et ambitions des classes dominantes. Ces dernières doivent faire en sorte que la soumission et l’obéissance soient toujours plus confortables et moins exigeantes que la révolte et la liberté…
L’avènement du capitalisme industriel pousse à son aboutissement la dialectique du maître et de l’esclave lorsque la terre et le travail – la « substance de la société », dirait Polanyi – deviennent des marchandises, lorsque les rapports entre patrons et salariés sont considérés comme purement contractuels, lorsque l’Etat garantit la propriété privée des moyens de production par le monopole de la violence légitime, lorsque les marchandises produites ainsi sont vendues sur le marché ; bref, lorsque les rapports entre le maître et l’esclave ne sont plus des rapports interpersonnels directs, mais qu’ils sont médiatisés par les forces impersonnelles de la valeur abstraite des choses et les contraintes structurelles, qui imposent leur arbitraire à tous avec une implacable nécessité[13].
Nos intellectuels matérialistes marxistes mettent également de côté le caractère hyper-industriel du capitalisme actuel. Lorsqu’ils citent Lénine, ils oublient que nous ne vivons plus au début du XXe siècle, sur une planète peuplée de paysans, avec en face un Etat dont l’armée est composée de conscrits avec de simples fusils, quelques canons et mitrailleuses, à peine équipée du télégraphe et du téléphone.
Ils n’ont pas l’air de comprendre les enjeux de la relation entre pouvoir politique et puissance matérielle dans les sociétés industrielles. Car la puissance physique, la force mécanique, la quantité considérable d’énergie qui est actuellement mobilisée pour assurer le fonctionnement du système est largement supérieure à celle que peuvent déployer des individus associés pour un coup d’Etat. La question du pouvoir est donc piégée par une autre question, celle de la puissance. Le pouvoir politique, c’est-à-dire l’appareil d’Etat, est dépendant de la puissance matérielle, économique et technologique, issue de l’industrie, et ne peut s’exercer que dans la direction de sa conservation et de son accroissement. Comment un Etat – fort qui plus est – pourrait-il asseoir son pouvoir sur un programme de réduction de sa puissance ? Ce petit paradoxe semble avoir échappé à nos brillants intellectuels !
Lénine avait théorisé, dès le début de la révolution russe, le « dépérissement de l’État » sous l’effet des avancées dans la réalisation du socialisme par la « dictature du prolétariat ». Par la suite, c’est tout le contraire qui s’est produit : afin de se protéger de toute contestation, la bureaucratie et l’Etat dits « soviétiques » sont devenus des monstres totalitaires.
Rappelons que les mesures dictatoriales prises par le pouvoir bolchevique ont débuté dans les campagnes par les réquisitions de blé[14], et que le basculement dans le régime totalitaire s’est accompli sous la forme de la destruction de la société paysanne, le fameux « plan quinquennal[15] ». Autrement dit, pour défendre leur position de classe, les marxistes-léninistes ont mené dans un premier temps une guerre contre la subsistance des paysans qui a abouti à la réalisation d’une « accumulation socialiste primitive », c’est-à-dire à l’expropriation violente des terres et des moyens de production. En Angleterre, ce processus s’était étalé sur plusieurs siècles, non sans conflits. Dans l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l’Etat et sa bureaucratie l’ont réalisé en moins de dix années au prix de millions de morts et de la destruction des campagnes.
Partout où des partis marxistes-léninistes ont aidé les paysans à lutter contre l’oppression féodale, ils ont férocement lutté une fois au pouvoir contre leur indépendance. C’est qu’ils ont compris mieux que quiconque que cette dernière était le principal obstacle à l’industrialisation : personne n’irait sous la férule de chefs trimer dans des mines et des usines s’il pouvait tirer sa subsistance en vivant libre à la campagne. L’industrie étant la source de puissance de l’État, la bureaucratie l’a imposée par la dictature pour se maintenir au pouvoir et jouir de ses privilèges.
Si nos intellectuels de gauche n’ont pas ces moyens, le fait qu’ils prennent pour modèle Lénine et dénient les leçons d’une histoire pourtant bien connue montre qu’ils sont – eux aussi – piégés par la marchandise et la société industrielle. Plutôt que de remettre en question celles-ci, ils sont prêts à prolonger l’exploitation capitaliste pour ne pas avoir à renoncer au confort marchand. Il est certes bien plus confortable d’invoquer abstraitement de grands changements historiques depuis son bureau que d’aller sur le terrain soutenir des bouseux de zadistes !
La critique du marxisme formulée par Makhaïski s’applique parfaitement à ces intellectuels prétendument critiques, qui ont perdu de vue le projet d’émancipation sociale et politique, et pour sauver la société industrielle ne voient d’issue que dans la fuite en avant autoritaire. Ils sont en cela au diapason d’une époque où le libéralisme autoritaire fait florès.
Au-delà, pour comprendre comment Lénine et une grande partie des marxistes se sont fourvoyés, il est nécessaire de comprendre quand et comment l’idée qu’il était possible de résoudre les problèmes sociaux par l’industrie et l’économie a pu sembler pertinente.
BERTRAND LOUART
Pages 77 à 84 de RÉAPPROPRATION – JALONS POUR SORTIR DE L’IMPASSE INDUSTRIELLE, chapitre III : « La trahison de la critique sociale », La Lenteur, 2022.
Notes
I. Première phrase de l’ouvrage de Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, 1852.
2. Traduction française dans la revue postmoderne Multitudes, n°56, octobre 2014.
* [cité page 75] “Le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme, conçue d’après le dernier mot de la science la plus moderne, sans une organisation d’Etat méthodique qui ordonne des dizaines de millions d’hommes à l’observation la plus rigoureuse d’une norme unique dans la production et la répartition des produits. Nous, les marxistes, nous l’avons toujours affirmé ; quant aux gens qui ont été incapables de comprendre au moins cela (les anarchistes et une bonne moitié des socialistes-révolutionnaires de gauche), il est inutile de perdre même deux secondes à discuter avec eux.” [Lénine, « Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites-bourgeoises », Pravda, 9-10-11 mai 1918.]
* [cité page 51]
3. Andréas Malm, op. cit., p. 211.
4. Ibid., p. 204.
5. Frédéric Lordon, « Et la ZAD sauvera le monde… », Le Monde diplomatique, octobre 2019.
6. Ibid.
7. Dans un autre registre, pour l’organisation américaine écologiste radicale Deep Green Resistance, ce n’est pas l’appareil d’État qui est au centre de ses préoccupations, mais l’avant-garde révolutionnaire qui s’emploie à mettre à bas le système industriel par des sabotages et autres blocages des infrastructures. Les « communautés alternatives » ne sont là que pour soutenir matériellement cette avant-garde et lui fournir des activistes loyaux et prêts à tous les sacrifices. Derrick Jensen, Lierre Keith et Aric McBay, Deep Green Resistance. Un mouvement pour sauver la planète, t. I, Paris, Libre, 2018, chap. IV « Une culture de résistance ».
8. Voir également la recension critique de son essai sur l’État, Imperium. Structures et affects des corps politiques (Paris, La Fabrique, 2015) par le philosophe anarchiste Renaud Garcia dans CQFD (« Lordon’s Calling », n° 137, septembre 2015).
9. Frédéric Lordon, « Le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment », entretien avec Joseph Andras du 9 novembre 2019, sur le blog du Monde diplomatique (blog[.]mondediplo[.]net).
10. En 1921, l’insurrection du soviet de Kronstadt avait pour mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux soviets et non aux partis ! » Sa répression par le pouvoir bolchevique, dirigée par Trotski avec l’accord de Lénine, devait sonner le glas du mouvement ouvrier russe et marquer la fin de toute résistance organisée au bolchevisme. Voir Ida Mett, La Commune de Cronstadt, crépuscule sanglant des soviets [1948], Paris, Spartacus, 1977.
11. L’ouvrage de Fabian Scheidler, La Fin de la mégamachine [2015], Paris, Le Seuil, 2020, raconte l’histoire de la civilisation dans cette perspective.
12. Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, op. cit. p. 299.
13. Voir Aurélien Berlan, « Pouvoir et dépendance », 2016.
14. Chantal de Crisenoy, Lénine face aux moujiks, Paris, La Lenteur, 2017.
15. Kostas Papaïoannou, « La prolétarisation des paysans » [1963], dans De Marx et du marxisme, Paris, Gallimard, 1983.
[via Indymedia]